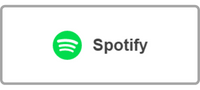ou écouter sur :
Mon partenaire Waalaxy est gratuit jusqu’au 28 novembre et à -50% pour Black Friday. Profitez-en pour transformer Linkedin en machine à leads.
Dans cet épisode du Podcast du Marketing, on explore le retour en force de la rareté comme levier stratégique.
Dans un marché saturé où l’abondance a fini par uniformiser les expériences, la rareté apporte du relief, de l’émotion et de l’engagement.
Vous apprendrez :
• Pourquoi la saturation de l’offre a relancé la quête d’exclusivité
• Comment la frustration active le désir plutôt que de l’éteindre
• Pourquoi les listes d’attente sont devenues un outil de pré-désir incontournable
• Comment les drops transforment chaque lancement en événement
• De quelle manière la rareté renforce la fidélité et l’attachement émotionnel
• Les limites éthiques et les risques d’un usage excessif de la rareté
Un épisode essentiel pour comprendre pourquoi les consommateurs veulent précisément ce qu’ils ne peuvent pas avoir… et comment les marques orchestrent ce paradoxe.
—————
🔔 Pensez à vous abonner au Podcast du Marketing
💌 À rejoindre ma newsletter
⭐⭐⭐⭐⭐ Et à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify
—————
Et puis sinon, vous pouvez aussi
Vous rendre visible en sponsorisant le Podcast du Marketing ou sa newsletter
Découvrir mes accompagnements marketing
Me suivre sur Linkedin
Transcription de l’épisode
Introduction
Vous êtes au cœur de la semaine du Black Friday, ce moment où les promotions s’affichent partout, où les marques rivalisent de superlatifs pour pousser à l’achat immédiat et où l’abondance semble devenir la norme. Pourtant, au milieu de cette frénésie d’ultra-consommation, une tendance inverse prend de plus en plus d’ampleur. Une tendance qui repose non pas sur le “toujours plus”, mais sur le “rarement disponible”. Alors que les enseignes multiplient les offres sans fin, d’autres marques choisissent de disparaître momentanément pour mieux réapparaître. Elles annoncent des quantités limitées, organisent des listes d’attente interminables ou créent l’événement autour d’un drop qui se joue en quelques minutes.
Cette stratégie peut sembler paradoxale dans un marché saturé où tout paraît accessible en permanence. Pourtant, elle fonctionne. La rareté attire, stimule le désir et transforme l’acte d’achat en expérience. Elle réintroduit une dimension émotionnelle que les promotions massives ont souvent tendance à effacer. Dans cet épisode, nous allons explorer ce retour appuyé du marketing de la rareté. Vous découvrirez pourquoi vous voulez ce que vous ne pouvez pas avoir, comment les marques orchestrent cette frustration pour créer de la valeur perçue et ce que cette stratégie change dans la relation qu’elles entretiennent avec leurs clients.
Installez-vous confortablement. Aujourd’hui, on parle de frustration, de désir, d’attente… et d’un marketing qui se joue précisément dans tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre panier du Black Friday.
I. Pourquoi la rareté revient au cœur des stratégies marketing
1. La saturation de l’offre et la quête d’exclusivité
En observant l’évolution récente du marché, un paradoxe apparaît. Les consommateurs n’ont jamais eu autant de choix, d’accès et de possibilités d’achat, pourtant ils se montrent de plus en plus attirés par ce qui est difficile à obtenir. Cette quête d’exclusivité n’est pas anecdotique. Elle s’explique avant tout par une saturation profonde de l’offre. Les enseignes se livrent une compétition permanente pour capter l’attention. Elles multiplient les collections, les éditions spéciales, les promotions successives. Finalement, cette abondance finit par diluer la valeur perçue des produits.
Ce contexte pousse les consommateurs à chercher l’exceptionnel, ce qui leur permettra de se distinguer. Ils ne veulent plus seulement acheter un produit. Ils veulent ressentir quelque chose en l’achetant. Ils veulent appartenir à un cercle restreint, être parmi les “premiers”, les “heureux élus”, ceux qui ont réussi à se procurer ce qui n’était pas donné à tout le monde. Cette logique touche toutes les catégories, du luxe à la tech, en passant par la beauté, la mode ou même l’alimentation.
La rareté joue ici un rôle de filtre. Elle permet aux marques de recréer de la valeur dans un environnement où tout semble uniforme parce que tout est disponible partout et tout le temps. Cette restriction volontaire repositionne l’offre dans un espace plus émotionnel. Elle réintroduit de l’enjeu, donc de l’attention, donc du désir. La rareté ne vient pas remplacer l’abondance. Elle sert plutôt de correction à l’excès d’indifférence généré par un marché hyper-saturé. Ce qui compte n’est plus seulement ce que vous proposez, mais le fait que tout le monde ne puisse pas l’obtenir.
I. Pourquoi la rareté revient au cœur des stratégies marketing
2. Le mécanisme psychologique de la frustration et son rôle dans le désir
La rareté ne crée pas seulement de la valeur économique. Elle active surtout des ressorts profondément psychologiques. Lorsque quelque chose devient difficile d’accès, il ne s’agit plus uniquement d’un produit limité mais d’un enjeu personnel. Vous ne réagissez plus en tant que consommateur rationnel. Vous entrez dans un mécanisme émotionnel où la frustration joue un rôle central. Cette frustration n’est pas perçue comme un frein. Elle devient un moteur. Vous voulez davantage ce qui vous résiste.
Ce fonctionnement repose sur un principe simple. L’être humain attache une valeur plus élevée à ce qui lui échappe. Le cerveau interprète l’indisponibilité comme un signal de rareté donc d’importance. S’il n’y en a pas pour tout le monde, c’est que cela doit valoir quelque chose. Cette perception amplifie le désir bien plus efficacement qu’une énième réduction affichée en rouge sur fond noir. Contrairement aux promotions qui appellent à une action rapide sans véritable implication émotionnelle, la rareté crée un parcours mental. Elle introduit l’attente, l’incertitude, parfois même un soupçon d’adrénaline.
La frustration agit alors comme un catalyseur du désir, à condition qu’elle soit dosée. Une rareté trop forte décourage. Une rareté intelligemment orchestrée stimule. C’est dans cet entre-deux que les marques savent désormais positionner leur stratégie. Elles ne vendent pas seulement un produit. Elles vendent le frisson associé au fait de réussir à l’obtenir.
Cette dynamique prend tout son sens face à la saturation évoquée précédemment. Dans un univers où tout est immédiatement disponible, la frustration devient une rupture narrative. Elle surprend. Elle provoque. Elle engage. Elle redonne de la valeur à ce qui, sans elle, aurait pu passer inaperçu. C’est précisément cette mécanique émotionnelle qui prépare le terrain aux nouvelles formes de rareté que les marques mettent en place, et que nous allons explorer maintenant.
II. Les nouvelles formes de rareté organisées par les marques
3. L’essor des listes d’attente comme outil de pré-désir
Les listes d’attente se sont imposées comme l’un des outils les plus puissants du marketing contemporain. Elles ne sont plus réservées aux restaurants étoilés ou aux produits artisanaux haut de gamme. Elles concernent désormais des marques de cosmétique, de mode, de tech, de décoration, et même des services. Ce succès n’a rien d’un hasard. La liste d’attente permet de transformer un simple produit en objet de projection. Avant même de le posséder, le consommateur se voit déjà en train de l’utiliser. Il anticipe l’expérience. Cette anticipation construit un pré-désir qui devient souvent plus fort que l’envie initiale.
Contrairement à la rareté brute, qui peut apparaître arbitraire, la liste d’attente introduit une forme de légitimité. Vous n’avez pas eu l’objet, non pas parce que la marque vous l’a refusé, mais parce que d’autres l’ont voulu avant vous. Cette mécanique atténue la frustration tout en la rendant socialement acceptable. Elle vous positionne dans un groupe de personnes qui aspirent à la même chose. Vous devenez membre d’une communauté invisible unie par l’attente.
Les marques utilisent cette dynamique pour créer un engagement progressif. Chaque email de confirmation, chaque message indiquant que vous “approchez” du moment où ce sera votre tour, renforce l’attention et maintient l’intérêt. Le produit n’est pas encore là, mais il occupe déjà un espace mental. Cette disponibilité mentale est très précieuse parce qu’elle dépasse celle générée par une simple campagne publicitaire. Elle s’inscrit dans la durée. Elle crée un lien émotionnel bien avant l’achat.
En s’appuyant sur la saturation du marché et le rôle psychologique de la frustration évoqués précédemment, les listes d’attente permettent aux marques de maîtriser l’intensité du désir. Elles dosent la rareté en la rendant lisible, progressive, presque ritualisée. Elles créent un parcours où l’attente n’est pas vécue comme une contrainte, mais comme une preuve de valeur. C’est cette logique amplifiée que l’on retrouve dans la stratégie du drop, encore plus radicale et spectaculaire.
II. Les nouvelles formes de rareté organisées par les marques
4. La stratégie du drop et la montée du modèle “disponible seulement maintenant”
La stratégie du drop s’est imposée comme l’une des expressions les plus emblématiques du marketing de la rareté. À l’opposé de la liste d’attente, qui installe une anticipation progressive, le drop repose sur l’instantanéité. Il joue sur un moment précis, parfois annoncé à la dernière minute, durant lequel le produit devient accessible pendant un laps de temps extrêmement limité. Cette mécanique crée une tension immédiate. Vous n’avez pas “quelques jours pour réfléchir”. Vous avez “quelques minutes pour agir”. Cette urgence transforme l’achat en performance.
Ce format a été popularisé par les marques streetwear et les collaborations artistiques, mais il s’est rapidement étendu à la beauté, au luxe, à la culture ou même à l’alimentaire. Les drops apportent une dimension événementielle à l’acte d’achat. Ils ne se contentent pas de rendre un produit rare. Ils transforment sa sortie en un rendez-vous. Cette ritualisation répond directement à la dynamique psychologique évoquée précédemment. La frustration ne se vit plus dans l’attente, mais dans l’adrénaline de la tentative. Vous vivez un pic d’émotion, même si vous repartez les mains vides.
Cette instrumentalisation de l’instant est particulièrement puissante parce qu’elle rompt avec le rythme constant de l’hyper-disponibilité. Dans un marché saturé où tout se ressemble, le drop crée une parenthèse où le temps semble se contracter. Il redistribue les cartes. Il donne une impression de rare justice, où chacun peut tenter sa chance, où l’achat devient une forme de victoire. Les marques gagnent alors bien plus qu’un volume de ventes ponctuel. Elles créent du bruit, de la conversation, du partage social immédiat. Le drop devient lui-même un contenu.
Cette stratégie fonctionne aussi parce qu’elle ne cherche pas à remplacer l’offre continue. Elle vient l’interrompre. Elle casse la routine, bouscule les attentes, et rappelle que même dans un monde d’accès illimité, certaines opportunités restent exceptionnelles. Cette montée en puissance du modèle “disponible seulement maintenant” redéfinit la relation entre la marque et son audience, ce que nous allons approfondir dans la prochaine partie.
III. Ce que la rareté change dans la relation marque-client
5. Comment la rareté renforce l’engagement et la fidélité
La rareté ne se limite pas à créer un pic d’attention. Elle transforme durablement la relation entre une marque et ses clients. Lorsqu’un produit se mérite, lorsqu’il faut le guetter, s’inscrire, patienter ou tenter sa chance, l’engagement ne naît pas uniquement au moment de l’achat. Il s’installe bien en amont. La marque occupe progressivement un espace émotionnel privilégié. Vous ne consommez plus seulement un produit. Vous vivez une expérience avec l’enseigne qui le propose.
Ce phénomène est particulièrement visible lorsque la rareté est orchestrée sur plusieurs niveaux. Les listes d’attente créent un pré-engagement qui fidélise dès la phase d’anticipation. Les drops ajoutent une dimension événementielle qui transforme l’acte d’achat en challenge. Ces interactions répétées construisent une relation active, loin du schéma traditionnel où la marque diffuse et le client choisit ou ignore. Ici, les clients participent, s’impliquent, adaptent leur comportement pour maximiser leurs chances. Ils parlent de la marque, surveillent ses annonces, suivent ses newsletters ou ses comptes sociaux de manière plus assidue.
Cette implication répétée renforce la fidélité. Non pas une fidélité basée sur la satisfaction uniquement, mais une fidélité basée sur l’histoire vécue. Les marques qui maîtrisent la rareté créent des rituels, des rendez-vous, des moments attendus. Ces moments deviennent autant d’occasions de renforcer le lien. Le consommateur revient parce qu’il veut revivre cette intensité. Il revient aussi parce qu’il sent qu’il appartient à une communauté de personnes qui ont partagé la même quête.
La rareté devient alors un moteur d’attachement, mais elle ne peut fonctionner qu’à condition de rester cohérente et mesurée. Elle doit être comprise comme une forme de respect accordé au produit et à l’expérience, pas comme un simple levier de manipulation. Si elle crée un rapport engageant, elle impose en retour une responsabilité accrue aux marques. C’est précisément là que commencent ses risques et ses limites, que nous explorerons dans la prochaine sous-partie.
III. Ce que la rareté change dans la relation marque-client
6. Les limites éthiques et les risques de backlash
La rareté peut renforcer la désirabilité et l’engagement, mais elle s’accompagne aussi de responsabilités. Lorsqu’une marque organise volontairement une pénurie ou mise sur la frustration, elle manipule des ressorts psychologiques puissants. Une stratégie trop agressive peut rapidement se retourner contre elle. Les consommateurs acceptent une part de tension ou d’incertitude tant qu’ils sentent que la marque joue franc jeu. Dès que la rareté semble artificielle ou qu’elle devient un prétexte à augmenter les prix sans justification, la perception bascule. La frustration s’accumule, mais elle ne nourrit plus le désir. Elle crée du ressentiment.
Cette frontière est d’autant plus sensible que la rareté touche à la notion d’équité. Si les clients ont le sentiment que certains ont accès à un produit parce qu’ils sont mieux connectés, mieux informés, ou privilégiés par un algorithme opaque, le backlash peut être immédiat. Les réseaux sociaux amplifient ces tensions. L’annonce d’un drop raté, d’une quantité jugée trop faible ou d’une liste d’attente interminable peut déclencher une vague de commentaires négatifs en quelques minutes. Une marque qui voulait créer de la légende se retrouve alors accusée de manipuler son audience.
La rareté peut aussi devenir contre-productive lorsqu’elle épuise le consommateur. Si chaque lancement demande une vigilance constante, une rapidité extrême ou une patience excessive, la relation peut perdre son sens. Les clients finissent par se détourner, non pas parce qu’ils n’aiment plus la marque, mais parce qu’ils n’ont plus l’énergie pour suivre le rythme. Le désir se transforme en lassitude.
Finalement, la rareté n’est pas seulement une stratégie. C’est un pacte. Elle engage la marque à offrir une expérience à la hauteur de la contrainte imposée. Elle l’oblige à rester cohérente, transparente, et à respecter l’investissement émotionnel de ses clients. Lorsqu’elle est bien utilisée, elle crée une relation forte. Lorsqu’elle dérape, elle peut détruire la confiance plus vite qu’elle ne l’a créée. C’est cette ligne subtile que les marques doivent apprendre à maîtriser.
Conclusion
Vous venez d’explorer les ressorts d’un phénomène qui prend de plus en plus de place dans le paysage marketing : le retour assumé de la rareté. Dans un marché saturé où tout semble accessible sans effort, la rareté agit comme un antidote à l’indifférence. Elle redonne du relief, elle recrée du désir, elle redéfinit la relation entre les marques et leurs clients.
Vous avez vu que la rareté répond d’abord à une fatigue collective face à l’abondance. Elle fonctionne parce qu’elle introduit de la tension, de l’émotion, parfois même un peu de challenge. Vous avez vu aussi qu’elle s’appuie sur des mécanismes psychologiques profonds. La frustration n’éloigne pas. Elle attire quand elle est mesurée. Elle transforme l’achat en expérience. Elle installe un lien plus fort que celui créé par une simple promotion.
Les marques jouent désormais sur plusieurs formats pour activer ce désir. Les listes d’attente, qui installent un pré-engagement durable. Les drops, qui transforment chaque lancement en événement. Ces outils ne se contentent pas de rendre un produit désirable. Ils créent une dynamique relationnelle. Ils construisent un attachement qui dépasse la satisfaction immédiate.
Cette stratégie n’est pourtant pas sans limites. Elle impose une responsabilité. La rareté ne peut pas être un jeu permanent, ni un artifice destiné à manipuler. Elle doit conserver un sens, une cohérence, une transparence. Sinon, le backlash n’est jamais loin. Les consommateurs ont appris à décoder les ficelles. Ils récompensent l’authenticité. Ils sanctionnent l’abus.
Alors comment intégrer la rareté dans votre stratégie marketing ? Commencez par une question simple : qu’est-ce qui, dans votre produit, mérite réellement d’être rare ? Une bonne rareté se construit autour de la valeur. Une mauvaise rareté s’impose autour du manque. La première crée du désir. La seconde crée de la méfiance.
Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner au Podcast du Marketing pour ne manquer aucun des prochains sujets. Si vous pensez que la rareté peut jouer un rôle dans votre propre stratégie, partagez cet épisode à quelqu’un qui pourrait en tirer profit. Vous contribuerez peut-être vous aussi à faire évoluer la manière dont les marques créent du désir aujourd’hui.
stratégie marketing, communication, email marketing, marketing digital, chatgpt, ia, intelligence artificielle, Google, SEO, SGE, brand content, personal branding, stratégie digitale, drop, liste d’attente