>> Répondez à l’étude ‘CMO & Marketing 2026: priorités, arbitrages et nouveaux équilibres’ et recevez les résultats en priorité <<
Comment lever 15 millions d’euros sans VC ? Dans cet épisode, avec Matthieu Gueniffey, co-fondateur de Galeon, nous décryptons une levée de fonds participative où le marketing est le moteur de l’investissement. Mission avant la tech, pédagogie, communauté et FOMO : une leçon de marketing appliqué à l’investissement.
Pour en savoir plus vous pouvez suivre Matthieu Gueniffey sur LinkedIn ou découvrir la nouvelle levée de fond de Galeon (investir comporte des risques).
—————
🔔 Pensez à vous abonner au Podcast du Marketing
💌 À rejoindre ma newsletter
⭐⭐⭐⭐⭐ Et à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify
—————
Et puis sinon, vous pouvez aussi
Transcription de l’épisode
Aujourd’hui, je vous emmène sur un terrain où je vais rarement.
On va parler de levée de fonds. Et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez : l’univers des startups n’a jamais été mon point de départ. Mon parcours, il s’est construit dans des grands groupes, chez Microsoft, Ogilvy, Altadis… Des environnements où, très concrètement, “lever des fonds” n’est pas un sujet du quotidien. On parle stratégie, marque, acquisition, growth, organisation. Mais on ne passe pas ses journées à convaincre des investisseurs de mettre un ticket.
Et puis il y a une autre raison pour laquelle je parle peu de financement ici : d’habitude, une levée n’est pas directement un sujet marketing. Bien sûr, il y a toujours un deck, une histoire, des métriques… Mais, dans l’imaginaire collectif, la levée de fonds, c’est un sujet de finance. De business model. De table de cap’. Pas un sujet de marketing.
Sauf que l’épisode d’aujourd’hui change complètement la donne.
Parce qu’on va décortiquer une levée de 15 millions d’euros pour un produit tech, dans un secteur aussi sensible que la santé… et surtout : une levée où le marketing n’est pas “un habillage”, ni un support. Le marketing est le moteur principal de l’investissement.
Et ça, ça m’intéresse énormément.
Comment est-ce qu’on arrive à mobiliser des dizaines de milliers de personnes, pas des fonds d’investissement, pas des “VC”, mais Monsieur et Madame Tout-le-monde, pour financer une vision ? Comment est-ce qu’on rend désirable, compréhensible et crédible un projet complexe, à la croisée de la healthtech et de la crypto ? Qu’est-ce qui fait qu’à un moment, quelqu’un se dit : “Je mets mon argent là-dedans” ?
Pour en parler, j’ai invité Mathieu Guéniffey, cofondateur de Galéon. Et ce que vous allez entendre, ce n’est pas une masterclass de finance. C’est une leçon de marketing appliqué à l’investissement : mission avant la tech, pédagogie, transparence, communauté, gamification… jusqu’à cette mécanique très précise qui transforme l’attention en action.
Bref : si vous pensez que “lever des fonds” ne vous concerne pas, restez avec moi. Parce qu’au fond, on ne va pas parler d’argent. On va parler d’un sujet qui nous concerne tous : comment le marketing peut faire bouger le réel.
Estelle (00:07.434)
Bonjour Mathieu, bienvenue sur le Podcast du Marketing.
Matthieu Gueniffey (00:10.773)
Bonjour Estelle, merci beaucoup de m’inviter.
Estelle (00:12.462)
Je suis vraiment très contente de te recevoir. Aujourd’hui, on va parler de financement. Je parle assez peu de financement, que les startups ne sont pas mon univers. Mais je trouve que c’est intéressant, surtout que toi avec ton entreprise Galéon, vous avez choisi un système de financement qui est assez innovant. Tu vas nous en parler avant que tu rentres dans le vif du sujet. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Matthieu Gueniffey (00:37.991)
Merci beaucoup. Alors moi c’est Mathieu Guéniffet, je suis papa de deux enfants, de garçons. J’ai un parcours, on va dire, au début assez classique, c’est-à-dire que j’ai fait une école de commerce, j’ai fait Kedge sur Bordeaux. Après j’ai fait une année, on va dire, où j’ai pu toucher un petit peu ce qui était Web Marketing, Web Design, Web Développement à Digital Campus aussi sur Bordeaux. Et puis j’ai fait une dernière année, on va dire, une école de commerce plus connue, c’est HEC Paris où là c’était plutôt un programme entrepreneur.
parce que j’avais déjà à cette époque-là Montégaléon. Et en fait, avant de Montégaléon, j’avais mon auto-entreprise, j’étais freelance clairement dans tout ce qui est marketing digital. moi, le marketing, c’est vraiment ce qui me passionne depuis le début, on va dire depuis l’école de commerce, clairement. Et donc j’ai monté cette petite entreprise où je gérais plutôt des gros clients sur le community management, sur les publicités Facebook, Meta, etc.
Ça c’était la première chose que j’ai faite. J’ai jamais été salarié en fait, jamais été salarié. J’ai toujours monté quelque chose. Parce que même avant je montais des petits serveurs sur ce qu’on appelle GTA. GTA San Andreas pour ceux qui connaissent, ceux qui sont un peu geeks on va dire. C’était… Ouais, alors j’ai… Exactement, c’est ça, c’est c’est jeu vidéo. Si, si, si, c’est jeu vidéo. Sauf que je montais des serveurs roleplay. Donc c’est-à-dire que tu incarnais des personnages clairement. Tu incarnais un policier, un maire, un mafieux, peu importe.
Estelle (01:48.238)
Ben ouais parce que là tu m’as perdu. GTA pour moi c’est des jeux vidéo. Non c’est pas ça. bon c’est ça ? Ok.
Estelle (01:58.701)
Ok.
Matthieu Gueniffey (02:03.573)
Voilà, j’ai monté ça à l’époque. Après, que d’autre plus, aujourd’hui je suis sur Annecy, c’est une très jolie ville où il a le lac et la montagne. voilà, gros, et puis ensuite on a monté Galeon avec mes co-fondateurs, on était cinq à la base, notamment Loïc Breton, qui est le médecin nécessaire animateur, qui est le CEO de Galeon. Et moi je suis co-fondateur et vice-président de Galeon, CEO en version anglaise. Voilà.
Estelle (02:29.966)
Super. Est-ce que tu peux nous dire, Mathieu, ce que fait Galéon Tu m’as expliqué un peu en off, j’aime beaucoup la mission de l’entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer, s’il plaît ?
Matthieu Gueniffey (02:41.633)
Ce qu’il faut savoir c’est qu’aujourd’hui 80 % des données dans les hôpitaux sont non exploitable. On ne clairement rien en faire. Et pourtant on le sait les données de santé elles valent énormément, elles valent de l’or. En fait elles sont enfermées dans des logiciels qui datent des années 90-2000. Le système d’exploitation n’est pas Windows XP mais les logiciels ressemblent à Windows XP. Donc avec Galeon on a créé le système d’exploitation de l’hôpital du futur.
pour que vos données puissent sauver des vies tout en redonnant aussi un petit peu de pouvoir aux gens sur leurs données grâce à la blockchain. Alors je dirai un petit peu plus plus tard sur l’explication de la blockchain pour qu’on utilise la blockchain chez Galeon. Mais voilà ce qu’il faut savoir c’est qu’aujourd’hui il a 18 hôpitaux qui utilisent Galeon. Donc c’est vraiment d’un côté le logiciel métier des soignants, c’est ce qu’on appelle un dossier patient informatisé, ça c’est ce qui existe dans 18 hôpitaux avec 10 000 soignants qui utilisent au quotidien et plus de 3 millions de dossiers patients. Et de l’autre on a tout cet entraînement.
en fait, d’IA médicale de façon décentralisée. C’est là où la blockchain entre en jeu, où finalement les données restent au niveau local de l’hôpital, donc elles ne sortent pas de l’hôpital. Et nous, ça nous permet de préserver l’habit privé des patients tout en entraînant de l’IA médicale.
Estelle (03:55.982)
Alors attends, que j’essaye de résumer quand tu m’expliquais.
Parce que c’est vrai qu’en tant qu’usager, on se rend compte que l’hôpital, c’est quand même un petit peu archaïque. Je te faisais rigoler parce que je te parlais de ma dernière expérience à l’hôpital où il fallait que je présente mes autocollants pour pouvoir voir un médecin, je trouvais ça complètement dingue. Mais en fait, c’est vraiment ça, que tu m’expliquais, c’était que c’est quand même encore assez archaïque globalement les dossiers médicaux au sein de l’hôpital. Et que vous, ce que vous proposez à Vagaléon…
c’est un dossier médical informatisé qui fait que si je vais dans un hôpital A un jour et qu’on traite une pathologie lambda et que deux ans plus tard je vais dans un hôpital B qui utilise bien sûr les deux utilisants Galéon, bien ils auront accès directement aux informations de l’hôpital A pour pouvoir voir tous les éléments et en fait avoir un seul et même dossier pour un patient qui te suit un petit peu partout dans les différents hôpitaux.
Matthieu Gueniffey (04:52.807)
Exactement. Exactement, en fait, c’est ça. C’est d’un côté, si tu as Galeon, que tu habites à Marseille et que tu vas en déplacement à Paris ou que tu as une urgence sur Paris, si les deux hôpitaux ont Galeon, le partage de données se fait en un clic. Donc il y a un gain de temps énorme pour les soignants, surtout en ce moment, on le sait, les soignants sont en train de faire des grèves. Pourquoi ? Notamment parce que les dossiers, crée des burn-out aujourd’hui, des dossiers qui sont tellement vieux que ça leur fait perdre énormément de temps l’administrative. ils n’en peuvent plus.
Estelle (05:13.614)
bien
Matthieu Gueniffey (05:18.311)
Et pour toi en tant que patient ça te permet très vite d’avoir un transfert d’informations et donc si j’ai des allergies, j’ai des traitements, si j’ai des problèmes particuliers, en fait le soignant qui va être dans l’hôpital qui n’a pas l’habitude de me voir mais qui a galéon, et bien il aura toutes ces informations là en un clic. Et ça c’est hyper puissant.
Estelle (05:32.398)
Trop bien, trop bien.
Non mais ça paraît ce que je te disais, moi ça me paraît fou que ça n’existe pas déjà, donc tant mieux, tant mieux que Galéon soit là. Ce que tu m’expliquais aussi, c’est qu’il a tout un pan IA d’entraînement de la donnée, de façon… Alors tu m’expliquais que c’était anonyme et que bien évidemment on n’utilise pas la donnée des gens sans leur consentement, mais en tout cas d’entraînement des gens pour le développement médical finalement et de pouvoir aller développer d’autres logiciels qui vont permettre, me donnais l’exemple, de mieux déceler par exemple un cancer du sein ou des choses comme ça,
On a besoin évidemment des IA qu’elles soient entraînées sur des cas concrets. Donc super intéressant comme… Enfin en tout cas moi je n’y connais rien mais je trouve ça passionnant, donc bravo. Super intéressant comme logiciel à développer. Mais ce pas vraiment pour ça que je voulais qu’on discute ensemble aujourd’hui, Mathieu, parce que moi évidemment ce pas tant le médical ma partie, c’est plus le marketing. Ce qui m’intéressait c’est qu’avec Galéon, évidemment vous avez eu besoin d’argent, fond pour développer ce logiciel, cette entreprise, ça paraît évident.
Mais vous avez eu un système de levée de fonds qui, je dirais, n’est pas commun. Souvent, quand on parle de levée de fonds, on pense à des fonds, des vici et on vient présenter un peu pour le commun des mortels, comme dans la fameuse émission qui veut être mon associé, je crois que ça s’appelle comme ça, je ne plus. Mais bon, voilà, on vient présenter devant des gens et on leur dit, donnez-nous des sous, on a besoin que vous investissiez pour. Vous, n’avez pas fait comme ça ou en tout cas, vous avez fait un petit peu différemment. êtes allé voir plein plein de gens, vous avez fait un système d’investissement.
Matthieu Gueniffey (06:49.503)
Oui, c’est ça.
Estelle (07:04.24)
participatif mais en crypto monnaie c’est ça
Matthieu Gueniffey (07:08.309)
Exactement en fait donc on se retrouve si je reviens un peu sur l’historique on se retrouve en 2021 2022 où en fait Galéon on avait trois clients à l’époque et on avait une demande énorme des hôpitaux de notre logiciel et donc on s’est dit ok moi qui suis dans la crypto donc appareil de crypto je suis dans la crypto depuis 2012 donc malheureusement
à l’époque il y avait le bitcoin qui existait et j’ai tout vendu avant, bon ça c’est un peu l’anecdote mais je suis pas devenu riche grâce à ça. du coup en 2020 on se retrouve à vouloir déployer des clients mais on n’était que 5, donc 5 confondateurs et on s’est dit ok comment on peut intégrer la blockchain dans notre écosystème et comment on peut aussi lever des fonds et rester indépendant. C’est aussi ça qui est important, c’est que cette levée de fonds communautaires en crypto monnaie nous a permis aussi de rester indépendant.
Estelle (07:32.078)
Ha
Estelle (07:48.11)
Mm-hmm. Ouais.
Matthieu Gueniffey (07:54.205)
Donc on a levé en fait 15 millions de dollars avec 40 000 personnes. Donc c’est des particuliers, ça peut être des boulangers, ça peut être des soignants, des médecins, des plombiers, peu importe. fait, y a tous les types de métiers des marketeurs. Il y a tous types de métiers qui ont investi, des personnes qui ont investi et qui finalement se sont raccrochées à vouloir un peu sauver ou révolutionner le système médical en France et va dire de plus largement mondialement.
Parce qu’on n’avait pas que des français quand on a fait cette levée de fonds. avait je pense 80 % de français et le reste était des pays étrangers. Donc voilà, ça nous a permis en fait de à la fois lever 15 millions de dollars, ce qui est une somme énorme pour une start-up. Et en plus de garder notre indépendance parce qu’on ne voulait pas de fonds. En fait, nous on crée quelque chose, ça fait déjà presque 10 ans qu’on est en train de créer Galon. Mais on voit à très long terme, on voit à 15, 20, 30 ans. Et finalement, comme tu disais, les fonds, les VCI, eux…
Ce qu’ils veulent c’est un retour à 5 à 7 ans généralement. Donc nous on ne pouvait pas faire ce système là et on n’avait pas forcément envie, on préférait faire participer à la communauté parce que typiquement, quand j’avais vu des boîtes dans le médical bien marcher, j’aurais voulu investir un petit peu avec mes économies. Sauf que je ne pouvais pas parce que c’est réservé aux fonds, c’est réservé aux Business Angels, c’est réservé à ces personnes là et à ces fonds là. Donc nous c’est ce qu’on a fait, voilà, on a fait de cette levée de fonds communautaires en cryptomonnaie, donc on a créé notre jeton. Les gens l’ont acheté à l’avance.
ce qu’on appelle une ICO, une Initial Coin Offering, c’est une levée de fonds commutés en crypto-monnaie. Et donc voilà, c’est comme ça qu’on a pu lever et avoir 15 millions de dollars avec 40 000 personnes.
Estelle (09:27.47)
Écoute, bravo parce que 15 millions de dollars, j’ai du mal à percevoir exactement ce que c’est, mais 40 000 personnes, je vois assez bien. C’est loin d’être rien d’un point de vue purement marketing. Si je mets de côté le côté finance, évidemment, ça se fait pas comme ça. C’est pas juste, j’arrive et je dis bonjour, salut, je m’appelle Mathieu, j’ai une boîte qui s’appelle Galéon, je vais révolutionner les dossiers médicaux dans le monde, donnez-moi vos sous. On est d’accord, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une stratégie, notamment une stratégie marketing pour que des gens
Matthieu Gueniffey (09:56.437)
Oui.
Estelle (09:57.424)
1. T’entendre, ça comprenne ce qu’est galléons, comprenne ce qu’est cette levée de fond et envie d’y mettre des sous.
Comment est-ce qu’on organise cette communication ? C’est ça qui vraiment m’intéresse. On en a parlé un petit peu en off tous les deux. Tu m’as dit que la première chose que vous avez faite dans votre stratégie marketing, stratégie de communication, c’est de dire on a mis la mission de Galéon avant la tech. C’est vraiment ça qui était le cœur de l’histoire. Est-ce que tu peux m’en dire un peu plus ?
Matthieu Gueniffey (10:31.871)
Et justement en fait, je pense beaucoup de Tone Audiences doivent connaître Simon Sinek, c’est en fait le why, c’est le pourquoi. C’est avant de… Parce qu’il y en a beaucoup dans la crypto-monnaie notamment qui vendent la spéculation, qui vendent la tech. Et ça c’est la plupart des projets, c’est ce qu’ils font. en gros, regardez ma technologie, elle va plus vite, ma technologie, elle coûte moins cher, etc. Nous en fait, avec Galéon, on a dit, grâce à Galéon, on va mieux soigner les gens.
En fait, on a déplacé le curseur de la spéculation à la réelle utilité de la blockchain et de la crypto monnaie dans notre cas d’usage, donc dans la santé. Finalement, on ne vend pas de la blockchain, on vend vraiment une révolution médicale, tu vois. Et c’est ça qui est important, c’est que…
Pour moi, je suis pas le seul, pense que quasiment tout monde, les gens n’achètent pas des lignes de code ou ils n’achètent pas de la complexité technique. Ils achètent généralement une vision du futur, un peu comme Elon Musk. Alors on l’aime ou on ne l’aime pas, mais Elon Musk, il vend, on va aller sur Mars. Alors il y a toutes les étapes intermédiaires, bien évidemment, on ne pas aller sur Mars tout de suite. Mais en fait, quand ils réutilisent ces fusées, aujourd’hui, c’est un bond énorme pour le spatial. Nous, c’est la même chose. En fait, on a vendu entre guillemets une vision du futur, du système de santé du futur, un dossier national de santé où…
Estelle (11:18.574)
sur.
Matthieu Gueniffey (11:43.035)
Demain on pourra utiliser l’IA pour détecter des cancers 5 ans ou 10 ans avant tu vois. C’est ça, c’est ça la différence entre vendre de la tech et vendre de la spéculation et vendre une réelle utilité et finalement le mieux soigner les gens.
Estelle (11:54.286)
Et je trouve… Alors évidemment la mission, on le sait, la mission c’est vraiment un levier ultra fort.
pour aller créer de l’action, pour faire agir les gens, c’est peut-être encore plus vrai parce que vous, vous vous adressiez, votre levée de fond, vous adressiez à des particuliers, enfin en tout cas à Monsieur, Madame, tout le monde. Donc ça peut être des professionnels, mais globalement c’est des particuliers en soi, parfois des professionnels de santé j’imagine, mais pas que là où si vous étiez allé devant des vicis, effectivement, peut-être que la mission les intéresse. Je pense que effectivement, probablement ça les intéresse aussi de voir à long terme ce que ça donne, mais fondamentalement c’est ce que tu me disais, eux ce qu’ils veulent voir,
Matthieu Gueniffey (12:10.421)
Oui. Exact.
Estelle (12:29.36)
leur retour sur investissement, c’est bien normal, c’est leur métier, il n’y a pas du tout de jugement de valeur là-dessus. Mais effectivement, dès lors que tu t’adresses au grand public…
Matthieu Gueniffey (12:30.911)
Exclame. Exactement.
Estelle (12:37.902)
la mission va être bien plus forte que l’argument financier qui sert très fort. Quand on investit de l’argent, peut-être on va aller à sa banque, chez son banquier, on va lui demander quel est le retour sur investissement. On ne pas le faire juste pour les beaux yeux du banquier ou de la banquière. et bien évidemment que le retour sur investissement est important, mais la mission, parle à l’émotion et l’émotion, on le sait, elle est beaucoup plus vectrice d’action que le rationnel. Donc super intéressant.
Matthieu Gueniffey (12:59.729)
Exitons.
Matthieu Gueniffey (13:05.233)
Fiction
Estelle (13:07.856)
d’être allé chercher d’abord la mission en premier lieu, ça s’applique pour moi à à peu près tout mais là peut-être encore plus parce que ça nous touche au coeur tout un chacun parce qu’on est tous et toutes concernés par la médecine tout simplement, la santé exactement. Ok donc première chose la mission Avant-Tech. Deuxième chose
Matthieu Gueniffey (13:23.226)
La santé, ouais, c’est ça.
Estelle (13:29.984)
Tu me parlais d’éducation. Oui, évidemment, c’est quand même un sujet complexe, donc il a fallu expliquer aux gens ce que vous alliez faire, comment ça allait fonctionner, etc.
Matthieu Gueniffey (13:40.917)
Exactement en fait il faut réduire la barrière à l’entrée parce qu’en fait un investisseur quand il comprend il est clairement rassuré et s’il est rassuré il investit. C’est important, on réduit la friction finalement, on réduit énormément la friction quand on fait ça. Donc la crypto et la santé c’est deux mondes complexes et un peu opaque. Donc notre rôle ça a été vraiment de finalement de devenir des traducteurs, des vulgarisateurs de la crypto et de la santé parce que nous en plus c’est encore plus compliqué c’est qu’on a les deux en même temps tu vois.
Donc finalement on a transformé ces concepts un peu complexes en schémas assez simples. Et dans les secteurs qui sont complexes comme ça, fait l’ignorance c’est vraiment le premier frein à l’achat. Genre quand tu connais pas, non moi je touche pas à ça, je connais pas, je comprends pas, je touche pas. Donc finalement on a fait de l’éducation un peu notre principale levier de vente. qui en fait à chaque contenu c’était très pédagogique, on faisait ce qu’on appelle des lives, des lives à maths, des ask me anything ou sur Twitch et sur Twitter à l’époque.
on faisait un live où on répondait aux questions, interrogations de la communauté, on en aurait dit voilà vous avez des questions, des Q &A, on répondait en live, on montrait nos têtes, ça c’est aussi important, c’est que pour assurer les gens, notamment en crypto, beaucoup de projets ne montrent pas leur tête. Nous en fait, a été là, on a été très transparent et on a éduqué les gens sur on est qui, a été notre background, pourquoi on fait ça et comment on le fait et de façon simple, on l’expliquait, tu vois. Et donc finalement, chaque contenu un peu pédagogique,
Estelle (14:48.334)
Mmh.
Estelle (14:53.962)
Ouais, ça fait peur.
Matthieu Gueniffey (15:09.449)
Voilà, c’est un outil de réassurance pour convertir et ça on a vu sur tout le process.
la levée de fond c’était une période mais encore aujourd’hui on fait encore des lives où on va avec notre communauté parce qu’on a quand même plus de 100 000 investisseurs donc on va faire un live où on va expliquer notre roadmap qu’est qu’on a fait cette année qu’est ce qu’on va faire l’année prochaine où est ce qu’on en est la vision de galéo etc. permet 1 de ne rester dans sa tour d’ivoire aussi en tant que fondateur parce que quand tu n’es pas sur le terrain et que tu n’as pas les investisseurs ou les clients par exemple tu sais pas ce qui se passe nous on est toujours en éducation permanente et en transparence
permanente avec finalement notre communauté tu vois et ça c’est important parce qu’en plus ce qu’il faut savoir c’est que notre communauté nous a amené du business c’est dire le fait d’avoir été transparent d’avoir créé cette communauté là ça nous a amené des clients des hôpitaux parce que il y avait des soignants parce qu’il a des personnes du service informatique qui étaient dans ces hôpitaux là qui ont dit ouais écoutez moi votre logiciel il me parle c’est exactement ce qu’on a besoin venez voir mon DSI mon directeur et on en parle ça aussi c’est intéressant
Estelle (16:10.63)
bien mais carrément et que je comprenne la communauté c’était uniquement sur twitch twitter où vous aviez une création de contenu sur je sais pas vous aviez un blog vous avez où est ce que vous communiquez
Matthieu Gueniffey (16:21.573)
Alors on a un blog, a LinkedIn, a X, a Instagram, on a Facebook, en fait c’est assez large parce que, ouais un peu partout parce que, alors ce qu’il faut savoir c’est que notre communauté de base elle est plutôt, c’est plutôt des 30, 50, 30, 60 ans tu vois, c’est le cœur de la cible elle est là. Alors on a beaucoup d’hommes parce que la cryptomonnaie c’est vrai qu’il a beaucoup d’hommes, mais de plus en plus on s’ouvre aussi aux femmes parce que déjà la médecine, rien que par les soignants, il y a beaucoup de femmes. Donc voilà un peu.
Estelle (16:26.9)
D’accord, partout quoi.
Estelle (16:51.854)
Super intéressant. Tu disais donc éducation, transparence, c’est clairement la base de tout. C’est-à-dire que si tu n’as pas de transparence, en tout cas si tu n’as pas confiance en l’autre, et surtout dans de l’investissement, et encore plus dans de l’investissement en crypto qui effectivement est un peu nébuleux, peut faire peur ou en tout cas quand on ne connaît pas.
ultra important donc d’être transparent. Tu me disais, on a même été transparent, même quand ça n’allait pas, parce qu’il a des moments qui sont évidemment dans la vie d’une entreprise, il des moments où ça va très bien, on a toujours envie de communiquer quand ça va très bien, c’est plus complexe parfois quand ça va moins bien. Là tu me disais, c’était important pour nous de venir communiquer, même quand c’était compliqué.
Matthieu Gueniffey (17:31.717)
Exactement, fait la confiance elle se gagne quand ça va mal, pas quand tout va bien. Dire la vérité en fait, quand tu as fait mal tu vois, il faut dire la vérité. Et finalement, moi si je prends un exemple, là où on a levé, c’était en 2021-2022, donc la crypto allait très bien jusqu’à 2022. en 2022 la crypto elle a craché de manière globale.
Donc il y a eu un crack et en fait, au lieu de se cacher, nous on a un peu ouvert les fenêtres. On a dit on va expliquer ce qu’on fait de chaque euro, on va mettre dans la tempête, expliquer ce qu’on fait, donc continuer ces lives, va être présents sur nos canaux, Telegram notamment, où on était en direct avec la communauté, où on répondait aux interrogations, etc. la communauté. Et finalement, vois, quand on a sorti notre, quand on a fait cette levée de fonds communautaire en cryptomonnaie, on a eu plein de détracteurs. Clairement, c’était à la fois cool parce qu’on levait des fonds, mais on a eu plein de, un scam, donc c’est une arnaque,
mais non mais ça ça sera jamais possible dans les hôpitaux publics parce que c’est trop compliqué, l’hôpital public il met du temps à bouger etc etc. fait clairement les gens disaient que c’était pas faisable ou alors que c’était une arnaque. Et ce qu’on a fait c’est que directement nous on répondait donc notamment c’était sur X, c’était sur Twitter à l’époque, où des personnes voilà…
disaient bah ça se fera jamais etc nous on répondait directement par vidéo donc on se filmait on disait voilà Galon c’est déjà présent dans trois hôpitaux dont un CHU et en fait on agitissait de façon transparente donc
chaque fois on produisait du contenu pour leur répondre et on essayait de répondre au maximum et finalement tu vois aujourd’hui on a 18 hôpitaux avec la grande majorité qui sont des hôpitaux publics donc donc si je revois ces quelques personnes aujourd’hui je peux leur dire que clairement bah ça fonctionne ça fonctionne
Estelle (19:11.214)
C’est ça fonctionne. C’était pas un scam. que je comprends d’ailleurs, moi qui n’y connais absolument rien en crypto, tu me dis il y eu un crack, la crypto s’est cassé la figure etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les fonds que vous avez levés, vous les avez perdus ? Comment est-ce que ça fonctionne ?
Matthieu Gueniffey (19:25.749)
Non, nous les fonds, les avait… Donc pour t’expliquer un petit peu, la crypto-monnaie, t’as deux types de crypto-monnaies. va dire t’as des crypto-monnaies qui sont volatiles et t’as des stable coins, donc des crypto-monnaies qui valent un dollar pour une crypto-monnaie, enfin pour un stable coin. Donc généralement, nous, enfin nous ce qu’on a eu c’était des stable coins. on n’a pas perdu d’argent sur le level 2.
Estelle (19:36.494)
Ok.
Estelle (19:41.883)
Ok. Donc l’argent n’est pas perdu.
Matthieu Gueniffey (19:44.149)
Non, l’argent n’est pas perdu, heureusement. Surtout que ça fait quatre ans qu’on a eu cette levée de fonds, donc ça nous a permis aussi de vivre quatre ans. Alors on a des chutes d’affaires, des hôpitaux, tout ça, mais ça nous a permis de tenir jusqu’à aujourd’hui. Par contre, de manière globale, la crypto-monnaie a chuté. C’est-à-dire qu’en 2022, il y eu des affaires un peu sulfureuses. Pour ceux qui connaissent, a eu FTX, était en fait une banque un peu crypto-monnaie, qui en fait a clairement été une arnaque et qui a entraîné une chute.
Estelle (19:46.574)
Oui.
Estelle (20:04.654)
Mmh.
Matthieu Gueniffey (20:10.771)
assez rapide de la crypto de toutes les crypto n’est du bitcoin de l’éthérôme de toutes les crypto monnaies et ça généralement quand toi tu as un projet qui a une crypto monnaie ça t’affecte un petit peu parce que ça dépend alors si tu es complètement financé par ta crypto monnaie en mode tu envoies un petit peu sur les marchés là bah elle vaut plus rien donc c’est compliqué et même si de manière globale les gens sont un peu sont un peu à fleur de peau parce qu’ils ont perdu de l’argent donc donc ça t’affecte dans tous les cas parce que ta communauté va moins bien que quand tout monte donc donc voilà
Estelle (20:26.392)
Ouais, c’est compliqué.
Estelle (20:37.215)
bien sûr.
Ok, mais vous en l’occurrence, ça n’a pas mis en péril du tout la société ni l’investissement des investisseurs, donc tout va bien. Ok, super, tu me rassures, tu m’as fait un petit peu peur dans une seconde. Génial. Tu me disais également, tu me parlais de GTA tout à l’heure, fais le lien, tu me disais que cette communauté de 40 000 personnes, parce que ce qui est compliqué avec une communauté, on va se dire les choses, c’est pas…
Matthieu Gueniffey (20:42.869)
Non. Non.
Matthieu Gueniffey (20:49.877)
…
Estelle (21:04.478)
toujours de la recruter. tout cas, la recruter, c’est souvent ce à quoi on pense en premier lieu. se dit, il falloir que je trouve les gens pour. Moi, ce je trouve qui est très compliqué avec une communauté, c’est d’alimenter la communauté, de faire en sorte qu’elle reste active et que les gens reviennent et que ça soit une communauté, que ce ne pas juste des gens qui disent, tiens, je viens mettre temps et puis qui repartent. Vous, avez travaillé beaucoup ce qu’on appelle la gamification, c’est-à-dire le fait de rendre les choses ludiques pour cette communauté. Tu peux m’en dire un petit peu plus ?
Matthieu Gueniffey (21:31.111)
Oui, en fait, on a clairement transformé notre communauté, grande partie de la communauté en super fan, super fan de Galéon. Et finalement, c’est transformer l’investissement en une expérience un peu ludique et sociale. Le besoin d’appartenance et de reconnaissance est hyper important. Et grâce à ça, grâce à la gamification, on a créé ce système là. à qu’on a créé, si je reprends un peu l’ICO, donc le levé de fonds communautaires, on a créé un système de PAC où en fait…
Quand tu mettais 200€, t’étais assimilé à une crevette ? Alors…
en fait crevettes c’est dans le monde de la crypto monnaie c’est un peu la culture c’est que de crevettes à jusqu’à baleine, baleine t’es très gros t’as beaucoup d’argent et crevettes t’as très peu d’argent donc on a un peu recoué les codes de la culture de la crypto monnaie donc tu mettais 200 euros tu t’as associé une crevette donc tu avais une petite image de crevette et c’était ton pack qui était représenté par une crevette tu avais je crois 25 000 euros si tu mettais si tu t’investissais 25 000 euros tu avais une baleine une image super jolie avec une baleine un peu stylisée et tout et si tu mettais encore au dessus 50 000 euros tu étais Godzilla le gros
Alors c’est vrai qu’il y avait beaucoup d’hommes donc ça marchait bien, sur les femmes ça marche peut-être un peu moins mais…
Estelle (22:35.82)
Ouais, ouais, mais c’est bien, en même temps il faut faire en fonction de sa communauté, donc ça marche.
Matthieu Gueniffey (22:39.801)
Exactement dans la crypto il y a encore beaucoup d’hommes donc voilà. Donc c’était un peu ces packs là où tu vois on avait une assimilation finalement à cette culture un peu de crypto bro comme on les appelle. et en fait finalement on a utilisé un petit peu les mécaniques du jeu vidéo pour valoriser l’engagement. Ça c’est ce qu’on a fait pendant le levé de fonds communautaires mais encore aujourd’hui on a une plateforme qui s’appelle Galeon Atlantis où les gens ils arrivent, ils s’inscrivent, ils créent leur pseudo, ils créent leur avatar.
Ils ont un choix d’un parmi plein d’avatars où ils peuvent s’associer à cet avatar-là. Pareil, il des packs où le pack représente soit une personnalité du monde de la médecine, soit autre chose, soit ça peut être aussi une voiture, la Lamborghini, ça peut être plein de trucs, fait, un peu ce qui te représente, ce que tu aimes bien. Et pareil, tu des quêtes.
ou grâce à ces quêtes, tu vas pouvoir aller liker sur les réseaux sociaux nos posts, tu vas pouvoir aller venir à un événement et gagner quelques points, gagner des récompenses, gagner des badges. Pareil, il a un système de badges où plus tu invite de personnes sur la plateforme, plus ton badge va devenir un badge important et impressionnant que tu peux partager. Voilà, c’est tous ces systèmes un petit peu de jeux vidéo, de gamification qui permet en fait d’entretenir la communauté sur le long terme.
Estelle (23:51.898)
Alors tu vois, ça m’intéresse vachement ce que tu me dis parce que moi je me suis… J’ai regardé depuis des années ce système de gamification avec des yeux toujours un peu… Bon, je ne sais pas. À la fois, je comprends complètement la mécanique. Tu le disais très bien, sentiment d’appartenance, sentiment de reconnaissance, c’est évidemment ultra puissant donc je comprends tout à fait la mécanique. En plus, le côté ludique avec…
Enfin je vais pas revenir sur les dix dernières années mais enfin ça a quand même pas été particulièrement drôle. Donc bien sûr que le côté ludique c’est quelque chose qui a une certaine appétence. Ça d’accord. Mais moi je regarde toujours beaucoup les Etats-Unis. Bon bref dans ma carrière j’ai eu l’occasion de travailler pas mal en regardant un miroir des Etats-Unis et en marketing on va se dire les choses c’est quand même souvent ça se passe souvent aux Etats-Unis d’abord. Et la gamification c’est vraiment quelque chose qui a été très très utilisé je sais pas il a quatre cinq ans c’était vraiment le truc qui était au coeur de tout.
Matthieu Gueniffey (24:36.373)
…
Estelle (24:44.176)
et ça en me disant ok fine sur les américains j’entends que ça marche très très bien parce qu’ils ont ce tu vois il a un côté culturel aussi le côté challenge et des coupes je remporte je fais des compètes des machins des rien nous on est en france un petit peu moins peut-être là dessus ça marche le côté badge le côté je te donne une récompense c’est bien apprécié par les par les français ça marche vraiment ou pas
Matthieu Gueniffey (25:06.901)
Ça marche super bien, ça marche super bien en fait. Tu vois, prends même si je… Donc là je parlais de galère, mais si je prends Duolingo, qui aujourd’hui apprend des langues grâce à Duolingo, je sais pas si y’a beaucoup… Enfin, je sais pas si on apprend plus des langues ou si on aime plus le côté gamification ou côté un peu ludique de Duolingo avec ses streaks en mode je reviens tous les jours. J’ai des gens dans la boîte qui me disent je suis à 1600 streaks.
Estelle (25:23.041)
c’est sûr.
Matthieu Gueniffey (25:32.561)
Je sais pas quoi faire, est-ce que je continue, est-ce que j’arrête ? Parce que pareil, quand tu perds ta strique, tu dois redébloquer ou repayer un petit truc. Voilà, c’est que finalement même Duolingo aujourd’hui, c’est même plus une app pour apprendre les langues, c’est plus pour jouer finalement.
Estelle (25:46.796)
Bah moi j’ai découvert que ma fille qui apprenait l’anglais sur Duolingo s’était mise aux échecs. lui mais qu’est-ce que fais ? Pourquoi tu fais des échecs ? Elle dit bah c’est Duolingo, ils m’ont donné des cours d’échecs. Bon ok d’accord.
Matthieu Gueniffey (25:51.605)
Voilà !
Exactement, en plus maintenant oui c’est vrai qu’il y a des échecs maintenant. voilà la gamification et notamment en plus sur les échecs ça marche bien il a chess.com la même application où c’est un petit peu gamifié t’as des cours etc. Ça marche super bien parce qu’aujourd’hui on a un…
Comment dire ? Comme tu dis, la situation économique et globale est un peu morose. On a envie de divertissement, on a envie, c’est comme Netflix, on adore Netflix. Bon, ben là, c’est des jeux vidéo, enfin c’est de la gamification sur les apps. Oui, ça marche en fait parce que tout le monde aime bien jouer un petit peu aux apps.
Estelle (26:24.66)
même quand on parle de choses sérieuses, en l’occurrence.
de données de santé, de crypto, d’investissement. fait, ça marche quand même parce que, comme tu dis, on est dans un monde qui est compliqué et que d’avoir un petit côté un peu sympa, un peu je me détends deux secondes et j’arrête de stresser. veux dire, là, tout va bien, tout va bien se passer. Finalement, ça a peut être un côté presque même rassurant. disais dans ce milieu là, il faut rassurer parce que c’est la première barrière à l’entrée. Le fait de ne pas comprendre, de ne pas savoir, d’avoir peur et que finalement, peut être que la gamification, participe aussi à la réassurance parce que
Matthieu Gueniffey (26:40.593)
C’est ça, exactement.
Matthieu Gueniffey (26:48.308)
Oui.
Estelle (26:57.104)
On se dit que ce pas si grave et que ça se détend et que tout va bien et que ça va bien se passer. Ok, écoute, super intéressant ton point de vue sur la gamification. Tu me disais aussi que tu fais vraiment intervenir la communauté. C’est quoi ? C’est des alliés marketing finalement, les personnes qui sont dans la communauté ?
Matthieu Gueniffey (27:17.034)
ça devient ton département marketing, clairement. fait, aujourd’hui, fait, oui, alors oui, les dirigeants communiquent, l’entreprise communique, mais finalement, on fait en sorte que ce ne plus l’entreprise qui parle, mais sa communauté ou ses investisseurs. C’est ça, la puissance et l’effet de réseau. C’est-à-dire qu’on a donné les clés de la maison, de la voiture à nos membres, enfin, à nos investisseurs. On leur a fourné en fait les outils.
que ce soit des systèmes d’affiliation, un système de parrainage, ce soit des images, du texte, des arguments, pour qu’ils puissent expliquer à leurs proches, à leurs familles, à quoi ça sert ce projet-là, pourquoi il faut investir aujourd’hui. Et tu le marketing généralement c’est un peu top down, c’est que c’est la boîte qui donne les infos à la communauté. Ce qu’on appelle le community led growth, c’est horizontal, c’est à que nous nos super fans on les a armés pour qu’en fait ça devienne nos meilleurs ambassadeurs.
Clairement. c’est ça, tout l’enjeu c’est que quand ton voisin te parle d’un projet c’est dix fois plus puissant que quand c’est une pub Facebook.
Estelle (28:15.982)
Bien sûr. Et lui, il n’a pas d’intérêt. Donc ce qu’il me dit, c’est probablement la réalité. Si c’est Mathieu Guéniffet qui me parle de Galéon, bah oui, Mathieu Guéniffet, il va pas me dire que Galéon, c’est tout naze. Ça paraît logique. Quand tu dis « les a armés », ça veut dire quoi ? Concrètement, vous leur avez donné quoi ? Des visuels, du message ? Qu’est-ce que vous leur donnez ?
Matthieu Gueniffey (28:38.363)
Ouais en fait typiquement ça c’est encore un truc qu’on travaille aujourd’hui parce qu’on a encore la communauté qui nous demande typiquement un peu un kit parrainage c’est à dire que dans ce kit parrainage tu vas avoir des images tu vas avoir un texte qui tient sur un A4 qui t’explique Galéon tu vas voir tous les chiffres clés de Galéon et en fait avec ça
Et puis peut-être aussi ton nom de parrainage si tu veux très facilement le partager ou un petit code et qui permet en fait d’avoir une commission sur ce que vont acheter les gens grâce à ton nom de parrainage. En fait on leur a donné des images, des visuels, les clés finalement pour aller parler à leur famille parce que comme je te disais c’est toujours plus puissant quand moi j’en parle à ma famille, quand j’en parle à mes amis que quand je vois une pub Facebook ou autre. Et c’est ça qui est intéressant c’est de faire un peu ce kit.
Estelle (29:06.062)
bien
Estelle (29:20.172)
bien sûr.
Matthieu Gueniffey (29:25.565)
Ouais, qui de parrainage en fait, qui permet très facilement en le déchargeant d’avoir toutes les clés pour pouvoir parler à ta famille ou à tes amis.
Estelle (29:33.038)
En fait, ce qu’il faut comprendre, je pense, c’est que…
Nous, marketeurs, tout ça, nous paraît très simple et très logique et très évident, mais ce n’est absolument pas le cas de l’immense majorité des gens. là, l’occurrence, ton audience, les gens qui sont membres de cette grande famille d’investisseurs galéons, ils sont pas forcément du milieu du marketing, ni de l’investissement, ni forcément du médical. Donc devoir expliquer le médical, devoir expliquer l’investissement, devoir expliquer comment tout ça fonctionne, ça fait beaucoup de choses. Et ça, marche en vrai pour n’importe quel marché, ce qui nous, nous semble évident parce qu’on
Matthieu Gueniffey (29:52.745)
et oui
Matthieu Gueniffey (30:03.507)
Ouais.
Estelle (30:06.448)
dans cette entreprise et parce qu’on a la tête dans le guidon, ça n’allait absolument pas pour le reste du monde. Donc simplifier, c’est comme tout, c’est comme dans le digital. Ce qu’on dit, c’est qu’il faut tout simplifier à la personne, à l’utilisateur, parce que s’il a l’occasion de s’en aller, il va s’en aller très très vite. C’est la même chose ici, il faut leur simplifier la vie. Ils sont déjà bien sympas de parler de Galéon. Il faut leur donner les clés pour que ça soit le plus simple possible, le plus vulgarisé peut-être possible aussi et qu’ils puissent en parler simplement et pas se faire envoyer promener aussi.
Matthieu Gueniffey (30:22.174)
Insecte.
Matthieu Gueniffey (30:35.623)
Exactement, c’est comme tu dis en fait, marketing c’est vrai que c’est souvent du bon sens. Mais quand toi, t’es dans ta boîte et que tu te dis tout est évident, je connais très mal mon produit, donc les gens pourquoi ils connaissent pas mon produit ou pourquoi ils comprennent pas. Mais en fait, ils sont pas dans ta boîte justement. Ils sont pas avec toi, ils sont pas dans ton département marketing, ils sont pas… Donc finalement, comme tu le dis, vulgariser, donner les éléments, les images, les textes, etc. qui te permettent…
Au final, très facilement, je suis investisseur de cette entreprise-là. Tant parle à ta famille, tant parle à tes amis. Et c’est ultra puissant. Nous, le système de referral ou de bouche à oreille, entre guillemets, c’était la moitié des gens de la levée de fond. La moitié des gens sont venus grâce à ça lors de la levée de fond.
Estelle (31:19.426)
bien, trop bien. Dernier point que je voulais qu’on aborde mais très rapidement parce que on a déjà passé beaucoup de temps à parler, parler de tout ça c’est super intéressant moi je pourrais en parler encore des heures avec toi mais vous avez utilisé un argument que j’adore, enfin que j’adore, qui marche en tout cas très bien mais qu’il faut réussir je trouve à doser bien comme il faut parce qu’il peut énerver aussi c’est le faux mot le fear of missing out donc la peur de louper quelque chose est que tu peux me dire comment vous l’avez travaillé ?
Matthieu Gueniffey (31:44.487)
En fait, le fear of missing out, c’est vraiment créer un sentiment d’urgence et un peu d’exclusivité de manière… Nous, on le fait de manière un peu justifiée et un peu éthique, va dire, sans manipuler les gens. Voilà, c’est pas ça l’idée. en fait, tu vas partir de train et t’as pas envie de le rater. Et nous, vois, clairement, cette levée de fond, elle a duré un mois. Pourquoi? Tu vois, les gens se mais pourquoi tu fais pas…
Estelle (31:57.646)
Mm-hmm.
Matthieu Gueniffey (32:12.725)
qui dure 4 mois à 6 mois parce que généralement quand tu lèves des fonds en tant que startup avec des VC tu mets 6 mois minimum tu mets 6 à 8 mois voire 1 an. Nous on a tout concentré sur 1 mois et tu avais différents rounds. Donc tu avais le premier round qui était le seed round donc là c’était plutôt la famille, les amis et on leur a dit voilà vous savez parce qu’en fait il y avait différents prix du jeton qui avait 1 centime, 2 centimes, 3 centimes donc c’était les différents rounds. Dans le premier round il avait 500 000 euros qu’on pouvait lever, on les a levés.
Ceux c’est la famille, ces amis, ces friends and families. En fait c’est pas le plus simple mais c’est ceux qui croient vraiment en toi donc c’est pas le plus dur à combattre. Par contre ensuite t’avais un round 1 public où là t’avais deux semaines, un prix intéressant de 2 centimes mais si t’es pas participé pendant ces deux semaines là, hop, tu passais directement sur le round 2 et c’est tant pis, c’est ton prix du jeton était plus élevé. Ton prix monte, Round 2, donc ce premier round on a levé je crois 1,5
Estelle (33:04.044)
remonte.
Matthieu Gueniffey (33:09.691)
Ensuite sur le deuxième round, tous ces effets cumulés, cette gamification, tout ce qu’on a créé, ça s’est accéléré sur la dernière semaine. Donc c’était sur un mois et la dernière semaine on a levé la moitié. Donc on a levé 6 à 7 millions sur la dernière semaine parce qu’on a eu les effets cumulés de tout ça. Et en gros tu avais deux semaines pour avoir 3 centimes. Et comme tout le monde voulait l’acheter, en vrai ça a fait énormément de bruit à l’époque dans le monde de la crypto, tout monde voulait l’acheter et finalement j’avais que deux semaines pour l’acheter. acheter ce jeton en galon.
Donc ça a précipité tout le et sur la dernière semaine ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, jusqu’à closer. En fait, c’était notre objectif 15 millions. Donc on a closé les 15 millions parce qu’il y avait différents rendes, parce qu’il y avait un peu la pression de si je rate, mince, comment je fais si je le rate ? ne pas, le reste sur les marchés parce qu’on va ensuite, tu le sors sur les marchés, mais ça sera peut plus cher. voilà, y a ce côté, ce n’est pas de la manipulation, mais c’est plus de jouer un petit peu avec ce côté rapide, exclusif.
Estelle (34:03.854)
Et puis c’est donné, moi je l’explique comme ça le faux mot, c’est donné une raison aux gens de prendre une décision.
C’est très dur de prendre une décision, pour n’importe quelle décision d’ailleurs, je pense aux décisions d’achat, mais ça peut être la même chose pour acheter des choses très très simples, acheter un téléphone, peu importe. Il faut prendre une décision, le cerveau aime pas prendre des décisions, donc il faut lui donner une bonne raison de le faire. Et le fait de se dire, c’est un fait, tu as jusqu’à après-demain pour prendre ta décision, sinon tu as une contrainte en plus, ça donne une vraie bonne raison de le faire. Est-ce que vous avez eu cette courbe en U qu’on a souvent quand on fait ce genre de choses ?
Matthieu Gueniffey (34:33.557)
Exact !
Estelle (34:39.376)
Au tout début, tu le SID, effectivement, tu as les gens qui de toute façon sont convaincus, ils viennent, ils se posent pas de questions. Et puis après, ça attend, ça attend parce qu’ils disent, ben attends, à la fois, je me rassure en voyant qu’il y en a d’autres qui viennent. C’est intéressant les différentes courbes, c’est que quelque part, bon, je prends pas de risque. Si d’autres ont pris le risque avant, c’est que je suis pas complètement idiot de prendre le risque, etc. Et puis, plus tu te rapproches du moment où tu as cette prise de décision, plus tu as deux raisons de prendre la décision. Et en plus d’autres personnes qui l’ont fait qui te rassurent. Et donc, tu as un gros pic sur la fin.
on voit ce genre de courbe.
Matthieu Gueniffey (35:09.461)
Oui, en fait on l’a eu clairement. C’est-à-dire que les 500 000 euros, les Friends and Family, ça on l’a fait en un mois aussi, à peu près un mois demi. Et quand on a commencé ensuite le premier round, ça a mis du temps. Ça a mis du temps clairement à se lancer parce que oui, il y avait déjà 500 000 mais c’était la famille, amis, c’était le seed. C’est clairement un peu plus facile mais c’est plus accessible. Donc on a eu cette phase descendante où au début on galérait première semaine, pas beaucoup, deuxième semaine, pas beaucoup.
3 semaines ça commençait à bien monter et là quatrième semaine explosion on a levé la moitié de la fin je vous ai dit 6 à 7 millions sur une seule semaine donc ça a été vraiment explosif
Estelle (35:47.532)
Ouais.
Faut être patient. C’est souvent un peu nerve breaking quand on organise ce genre de choses. Quand on utilise le faux mot, sachez le E en général, marche. tout début, ça marche très fort à la fin. Souvent, on dit que c’est sur le dernier jour. j’ai vendu beaucoup de formation. Mon premier métier, c’était de vendre de la formation. Et c’est vraiment sur le dernier jour en général, voire le jour d’après. Très rigolo. Pas toujours rigolo. Voir le jour d’après que les gens prennent la décision. Donc c’est normal, mais c’est dur.
Matthieu Gueniffey (36:02.034)
Exactement.
Estelle (36:18.162)
Je vais essayer Mathieu de résumer tout ce que tu nous as dit aujourd’hui sur cette levée de fonds participative un petit peu particulière. Ce que tu nous expliques c’est que il a plusieurs éléments.
qui ont fait que cette grosse levée de fond, parce qu’on peut le dire c’est une grosse levée de fond, en plus sur de la crypto qui n’est pas quand même un système qui est si connu que ça, en tout cas du grand public. Qu’est ce qui a fait que d’un point de vue marketing communication ça a marché ? La première chose, tu m’as cité Simon Synex, c’est d’aller chercher votre pourquoi, c’est de mettre la mission avant la tech, parce que les gens n’achètent pas, en tout cas le grand public. Ils n’achètent pas de la tech, c’est à dire un élément rationnel. Ils achètent une mission. Il a mon fils qui se prouve.
Romaine qui vient de passer derrière moi. Tout va bien, je vais essayer Martin si tu veux bien que je finisse mon résumé. Donc la mission avant la tech. Deuxième élément, c’est l’éducation parce qu’on a besoin d’aller réduire la barrière à l’entrée. On a besoin de rassurer. C’est un univers qu’on connaît sans connaître le médical. La tech plus la crypto. Donc là vous cumulez un peu tous les éléments. Pas simple d’y aller directement. Donc il faut
et tu me disais l’éducation vous l’avez fait via des lives sur twitter auprès de votre communauté vraiment directement de leur expliquer tous les éléments. Et là tu me dis il faut communiquer mais il aussi communiquer avec énormément de transparence parce qu’il a pas confiance sans la transparence et il n’y a pas d’achat, n’y a pas d’investissement sans la confiance. Donc absolue transparence. Un petit lutin qui se promène. Absolue transparence sur votre communication même quand ça va mal.
Tu me disais, on parle de crypto, dans la crypto, il y a des moments où c’est plus simple que d’autres. Garder la transparence, ça permet vraiment de créer cette confiance et créer une base qui est vraiment une base de fan. Et tu me disais, on a transformé notre communauté en super fan avec un vrai besoin d’appartenance, besoin de reconnaissance, tous ces éléments-là. Ça a été vraiment travaillé pour pouvoir faire en sorte que finalement, il communique pour vous. Et tu me disais, c’est devenu notre équipe.
Estelle (38:30.348)
marketing finalement les membres de la communauté. Cette équipe marketing, vous l’avez travaillé aussi avec ce qu’on appelle la gamification. Tu me disais que ça marche ultra bien. marche bien aux États-Unis. voyez la gamification, ça marche bien quand on a six ans. Ça marche bien aux États-Unis, mais tu me disais attends Martin, il faut quand même que tu me laisses finir chaton. Ça marche bien aux États-Unis, mais ça marche aussi très, très bien en France. Pourquoi ?
la vie est complexe, on est dans un univers qui est éminemment difficile et que dans ces cas là on aime pouvoir avoir un moment donné où les choses redescendent un petit peu et ça marche effectivement très bien. Cinquième élément, le community led gross. leur avez donné les outils pour pouvoir communiquer parce que c’est une communication complexe encore une fois on parle de crypto, on parle de médical, on parle de beaucoup d’éléments donc vous leur avez donné tous les éléments marketing finalement pour
communiquer facilement. Et dernier élément, le fameux FOMO, créer un peu d’urgence pour pouvoir mener à l’action. Quand on parle de FOMO, Mathieu, je crois savoir que 15 millions n’a pas suffi et que vous êtes en train de lever des fonds à nouveau. Est-ce que tu peux me dire quelle est la limite ?
Matthieu Gueniffey (39:48.821)
Exactement, fait, du coup, on a fait cette première levée de fonds en 2021-2022. On a levé 15 millions de dollars. Ça nous a permis de vivre jusqu’à ici, bien évidemment. On a aussi des études à faire des clients, bien évidemment. Donc, les hôpitaux payent un abonnement à SaaS, donc software de service. Aujourd’hui, on est en nouvelle phase de levée de fonds. Donc, c’est ce qu’on appelle les obligations publiques. Donc, ce n’est pas du tout en crypto, c’est plutôt en euros, clairement, où en fait, tout un chacun peut investir en obligations. nous, fait, la société fait un emprunt.
près des particuliers. Ces emprunts en fait sont en cours et c’est 8 % par an de rendement sur 7 ans, donc soit 56 % au total. Et en fait il y a différents packs qui sont disponibles donc à partir de minimum 400 euros jusqu’à 100 000 euros et ça se passe sur atlantis.gallon.cair.
Estelle (40:36.174)
J’allais te demander justement si on veut en savoir plus, où est-ce qu’on peut se trouver, te trouver. On peut déjà commencer par aller sur atlantis.galéon.cair. Je mettrai le lien dans les notes de l’épisode. Si on veut te parler directement parce qu’on veut en savoir plus, etc. où est-ce qu’on peut te retrouver, dis-moi.
Matthieu Gueniffey (40:46.418)
Exact.
Matthieu Gueniffey (40:52.245)
On peut me retrouver sur LinkedIn, Mathieu Guéniffet, pareil sur X, Mathieu Guéniffet, ou sur Instagram. Voilà, je suis un peu partout.
Estelle (40:59.226)
ben ok.
Vous trouverez tout ça dans les notes de l’épisode. Merci infiniment Mathieu, c’était passionnant de discuter avec toi. Merci d’avoir décrit comment articuler toutes ces stratégies marketing en une. Super intéressant et puis, coute longue vie à Galéo. espère que mon lutin se promenait. On espère en tout cas, les dossiers médicaux, on va passer un petit peu à l’ère, j’allais dire à l’ère supérieure. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça.
Matthieu Gueniffey (41:16.789)
Ça part… Ouais, il est…
Estelle (41:30.3)
mais qu’on arrête avec les autocollants à présenter à l’hôpital. Ce serait sympa. Merci beaucoup Mathieu. T’es bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing.
Matthieu Gueniffey (41:34.366)
Exactement. Merci beaucoup Estelle.
stratégie marketing, communication, email marketing, marketing digital, chatgpt, ia, intelligence artificielle, Google, SEO, SGE, brand content, personal branding, stratégie digitale, drop, liste d’attente



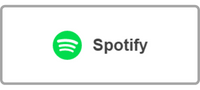




 Pensez à vous abonner au Podcast du Marketing
Pensez à vous abonner au Podcast du Marketing À rejoindre ma
À rejoindre ma 







